

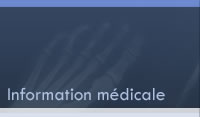

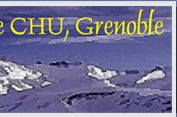
.jpg)
Bienvenue sur le site des Evénements et actualités
du service
de Rhumatologie du CHU Grenoble Alpes
mise à jour 23 03 2023
les Evénements du service de Rhumatologie du CHU de Grenoble Alpes
JOURNEE OSTEO ARTICULAIRE DE L'HOPITAL SUD
COLLOQUES DU MERCREDI DE LA CLINIQUE DE RHUMATOLOGIE DU CHU DE GRENOBLE